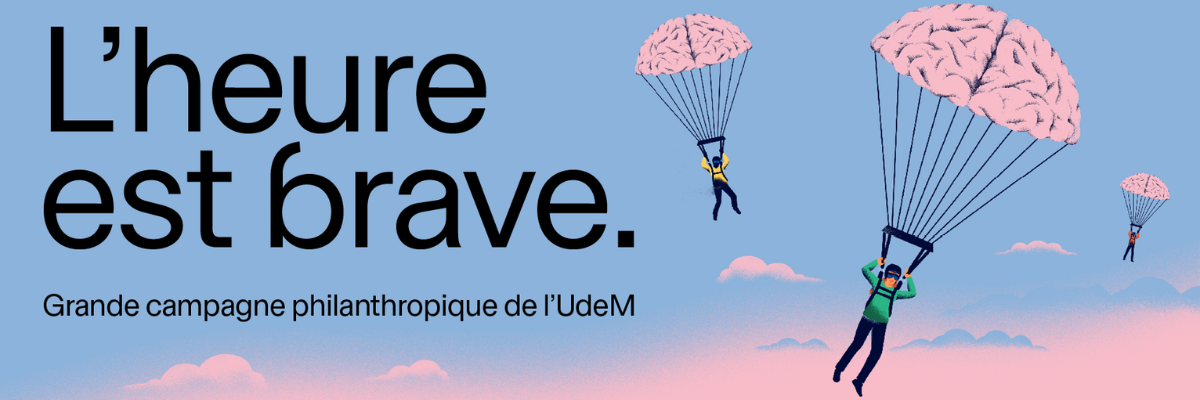Programme musical
Hänsel und Gretel
Engelbert Humperdinck
Jeudi 27 février et samedi 1er mars – 19 h 30
Salle Claude-Champagne
Atelier d’opéra et Orchestre de l’Université de Montréal
Geneviève Leclair, cheffe invitée (diplômée de la Faculté de musique)
Richard Margison et Robin Wheeler, direction de l'Atelier d'opéra
Robin Wheeler, direction du Chœur de l'Atelier d'opéra
Esther Gonthier, pianiste-cheffe de chant de l’Atelier d’opéra
Roxane Loumède et Patrick R. Lacharité, mise en scène
Gabriela Hébert, images et projections (étudiante au baccalauréat en musiques numériques)
Chanaël Burat, costumes
Catherine Fée-Pigeon, éclairages
Natacha Filiatrault, coiffures et maquillages
Laura Kubler, assistance à la mise en scène et régie (étudiante au DESS en médiation de la musique)
Carl Pelletier, accessoires et décors
Myriane Vorano, assistance aux costumes
Alice Chabot, surtitres (étudiante au baccalauréat en interprétation chant classique)
Hänsel und Gretel
Acte I : Daheim (à la maison)
Acte II : Im Walde (dans la forêt)
Entracte
Acte III : Das Knusperhäuschen (la maison en pain d’épices)
Livret de Adelheid Wette
Orchestration réduite par Jonathan Lyness
Mot des metteur·es en scène
Pour une deuxième année consécutive, nous avons le bonheur de pouvoir diriger les étudiant·es de l'Atelier d'opéra dans une production professionnelle. Pour certain·es, c'est l'occasion de faire leurs débuts sur scène et de vivre l'exaltation de se produire devant un public pour la première fois, et pour d’autres, de revenir sur les planches et d’approfondir un nouveau personnage. À l'instar de Hansel et Gretel, ils devront surmonter leurs appréhensions et avancer courageusement pour se surpasser.
Comment redonner vie à un conte que nous connaissons tous si bien, et de quelle façon avons-nous envie de le faire pour l’opéra ? Ce sont les premières questions que nous nous sommes posées. Bien que cet opéra soit fréquemment joué dans nos écoles, nous avons voulu explorer une approche différente. Pourquoi ne pas plonger dans l’univers des chanteur·ses et dévoiler l'envers du décor, celui de la création et de la magie qui émerge du travail collectif des artistes et de la troupe ?
Dans cette production, nous suivrons les chanteur·ses dès la première lecture, autour d’une simple table de répétition, jusqu’à la construction du monde scénique de l’œuvre. Petit à petit, le public sera invité à entrer dans l'univers du conte Hänsel et Gretel, qui se révélera progressivement devant leurs yeux.
Ce que vous découvrirez sur scène reflète également ce que nous avons cherché à transmettre tout au long de notre processus de création avec les étudiant·es. Dès les premières répétitions, nous avons cherché à instaurer une atmosphère de bienveillance entre les interprètes, en privilégiant l'esprit d'équipe et la solidarité.
Le contexte actuel de la crise du sous-financement des arts nous fait prendre conscience de l’importance de faire et de présenter de l’art vivant. Se rassembler pour assister à de l’art vivant - qu’il s’agisse d’opéra, de musique, de pièces de théâtre ou de danse - est un moment privilégié pour se réunir en tant que société, prendre le temps de réfléchir collectivement sur notre monde et y chercher des réponses à travers les œuvres qui le révèlent.
Un grand merci à Robin Wheeler et Richard Margison de nous permettre de vivre cette expérience exceptionnelle. Merci à la Faculté de musique d’avoir l’audace de soutenir une nouvelle génération de metteur·es en scène. Merci à Sarah, Laura, aux concepteurs·trices et aux étudiant·es de nous accorder leur confiance et de suivre notre proposition. Et enfin, merci à vous, cher public, d’être présent ce soir.
Bon spectacle !
Roxane Loumède et Patrick R.Lacharité
Synopsis
Hänsel et Gretel, opéra en trois actes du compositeur allemand Engelbert Humperdinck, raconte l’histoire de deux enfants, Hansel et Gretel, perdus dans la forêt et confrontés à une sorcière, Die Knusperhexe (Grignote dans la version française). L’opéra, inspiré du célèbre conte des frères Grimm, allie des éléments du conte de fée et du drame familial.
Acte I
L’action débute dans une modeste maison où Hansel et Gretel, deux enfants d’une famille sans le sou, aident leurs parents. Les enfants, vêtus de haillons (l’un a les bas troués, l’autre a les souliers percés), sont affamés. Malgré la faim, ils décident de danser ensemble. Mais leur mère, les surprenant en train de s’amuser, s’emporte et leur donne une correction. Lors de l’incident, elle renverse un pot de lait, brisant leur dernier espoir de souper. Dans un excès de rage, elle décide de les envoyer dans la forêt pour cueillir des fraises.
Le père, un marchand de balais, revient de la ville, heureux et un peu ivre, avec des victuailles. Lorsqu’il apprend ce que sa femme a fait, il s’inquiète et se précipite à la recherche de ses enfants. Il craint que la forêt ne soit hantée par une sorcière qui dévore les enfants égarés, et il se lance avec espoir à leur secours.
Acte II
L’action se déplace dans une forêt dense et sinueuse, où les enfants errent, perdus et fatigués. Alors que le crépuscule tombe, Hansel cueille des fraises et Gretel tresse une couronne d’églantines. Ils s’amusent en imitant les coucous, moment d’insouciance et de complicité dans ce cadre inquiétant. Cependant, leur joie est interrompue par l’apparition du marchand de sable, une figure mystique qui les plonge dans un sommeil profond sous les étoiles. Durant leur sommeil, une lumière surnaturelle perce la nuit et des anges apparaissent, apportant réconfort aux enfants et les veillant dans leurs rêves.
Acte III
À l’aube, Hansel et Gretel sont réveillés par la fée Rosée. En discutant de leurs rêves surnaturels, ils aperçoivent une maison étrange, entièrement recouverte de sucreries. La tentation est irrésistible et, malgré les réticences de Gretel, Hansel les entraîne à goûter les murs sucrés de la maison. Leur gourmandise attire l'attention de la sorcière Grignote, qui les piège. Elle capture Hansel, décidant de le nourrir de sucreries pour l’engraisser avant de le dévorer. Elle jette un sort sur le garçon pour le soumettre à sa volonté. Gretel, quant à elle, est chargée de préparer le four, mais elle n’abandonne pas l’espoir de libérer son petit frère.
La sorcière décide d’utiliser Gretel comme appât en lui ordonnant de vérifier la cuisson de la pâte dans un grand four attenant à la cage. Mais Gretel, rusée, feint l’incompréhension et demande à Grignote de lui montrer comment faire. Lorsque la sorcière se penche pour montrer la procédure, Hansel saisit l’occasion et la pousse dans le four.
Le sort enfin brisé, la maison en pain d’épices s’effondre, révélant une haie de petits enfants libérés de la malédiction de la sorcière. Hansel et Gretel retrouvent leur père et leur mère partis à leur recherche la veille. Dans la scène finale, les enfants, heureux de retrouver leurs parents, sortent du four la sorcière transformée en pain d’épices géant.
Distribution
Les solistes de l’Atelier d’opéra
Hänsel
Mia Rolland (27 février)
Maïlys Arbaoui Westphal (1er mars)
Gretel
Nicole Ross (27 février)
Kevisha Williams (1er mars)
Gertrud
Anastasia Broch (27 février)
Marion Germain (1er mars)
Peter
Théo Raffin (27 février)
Élie Lefebvre-Pellegrino (1er mars)
Die Hexe (La Sorcière)
Pierre Heault
Sandman (Le Marchand de sable)
Daphnée Brideau (27 février)
Julie Boutrais (1er mars)
Taumännchen (La Fée rosée)
Daphné Dubois (27 février)
Anne-Sophie Gagnon-Métellus (1er mars)
Le Chœur de l’Atelier d’opéra
Sopranos
Daphnée Brideau
Daphné Dubois
Louise Seide
Marie France Eba Koua
Anne-Sophie Gagnon-Metellus
Mezzo-sopranos
Julie Boutrais
Galane Le Guennec
Gwynneth Hudson-Jameson
Ornella Baquet
L'équipe artistique
Geneviève Leclair

Cheffe d’orchestre
Geneviève Leclair est très active en tant que cheffe invitée au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, dans le monde symphonique, au ballet et à l’opéra. Elle est aussi professeure agrégée de direction d’orchestre au Berklee College of Music où elle enseigne depuis 2016. Les faits saillants de la saison 2024-25 incluent ses débuts avec Canada’s Royal Winnipeg Ballet, Houston Ballet et Regina Symphony Orchestra.
Elle a été Première chef invitée de l’Orchestre Classique de Montréal en 2022-23, assistante chef d’orchestre puis chef invitée au Boston Ballet Orchestra de 2010 à 2017, directrice musicale de Parkway Concert Orchestra de 2013 à 2019 et membre du conseil d’administration de l’International Conductors Guild de 2017 à 2020.
Ses interprétations ont été encensées par la critique comme étant « impeccables » (Boston Phoenix), « ravissantes » et « d’une lecture et d’un momentum exemplaires » (Hugh Fraser) tandis que son style de direction a été célébré pour sa « verve et sa précision », « ses nuances et ses tempos surs, ses rythmes impeccables, et son phrasé cristallin créant un puissant élan » (Carla DeFord).
Passionnée d’art collaboratif et engagé, elle a dirigé la création du segment du Saskatoon Symphony de The [uncertain] Four Seasons, un projet mondial visant l’action face aux changements climatiques initié en Australie avant le sommet sur le climat COP26. Elle a également créé un programme sur la conservation des insectes en collaboration avec les Sudbury Valley Trustees pour le Wellesley Symphony. Avec l’Orchestre Métropolitain, elle a dirigé la création du Pelleteur de nuages, une pièce sur l’acceptation basée sur un personnage de livre pour enfants. En 2020, Geneviève a dirigé la première québécoise de l’opéra As One - l’histoire d’un personnage transgenre - de Laura Kaminsky avec l’Orchestre Classique de Montréal dans une web diffusion encensée par la critique et disponible sur OuTV. En plus de ces projets, Geneviève maintien un horaire chargé d’engagements comme chef invitée avec de nombreux orchestres The National Ballet of Canada, Calgary Philharmonic, Spartanburg Philharmonic, Northern Ballet, Orchestre Symphonique de Sherbrooke, Jeunesses musicales Canada, Symphony New Brunswick, Symphony New Hampshire.
Son répertoire de plus de 50 ballets inclut la plupart des grands chefs-d’œuvre romantiques et du 20e siècle, dont quinze ballets de Balanchine, Roméo et Juliette et Onegin de Cranko, Symphonie de Psaumes de Kylian, Études de Lander, Chroma de McGregor, Nijinsky et La Troisième Symphonie De Gustav Mahler de Neumeier, La Belle au bois dormant et Don Quichotte de Nureyev, La Belle au bois dormant, La Bayadère et Le Lac des cygnes de Petipa, Giselle de Wright, Cendrillon de Ashton.
Geneviève a remporté le American Prize 2017 en direction d’orchestre, division collège/université et s’est classée à la 2e place de la division professionnelle. Au printemps 2010, Geneviève a eu l’honneur de recevoir la bourse de direction d’orchestre de la Fondation commémorative Sir Ernest MacMillan. Elle est titulaire d’un doctorat en direction d’orchestre de la Boston University sous la tutelle de Maestro David Hoose. Elle a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en interprétation de la flûte traversière à l’Université de Montréal, cette dernière sous la supervision de Denis Bluteau, flûte solo associé à l’Orchestre Symphonique de Montréal.
Robin Wheeler

Codirecteur de l’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal
Directeur du chœur de l'Atelier d'opéra
Pianiste-chef de chant et professeur agrégé à la Faculté de musique
Robin Wheeler est un pianiste accompagnateur et répétiteur très apprécié des chanteuses et chanteurs. Au cours des dernières années, il a agi comme répétiteur, entre autres, lors de la production d’Elektra de Richard Strauss a l’Orchestre symphonique de Montréal. Lors de ses cinq années passées à l’Opera North du New Hampshire comme répétiteur principal et chef adjoint, il a participé à des productions de Tosca, Les contes d’Hoffmann, Ariadne auf Naxos, Carmen et La traviata.
On l’a également entendu comme accompagnateur sur les ondes de la Vermont Public Radio et de la radio de la CBC. Au cours des derniers étés, il a été répétiteur principal des productions de Le nozze di Figaro de Mozart, de Filumena, Frobisher et de Lillian Alling de John Estacio et John Murrell, au Banff Centre for Arts en Alberta.
En avril 2007, il faisait ses débuts avec la société Opera in Concert de Toronto, en tant que directeur musical de l’opéra Die tote Stadt de Korngold. En été 2013, il a été répétiteur principal d’Owen Wingrave de Britten au Banff Centre for Arts. Depuis l’été 2013, il est aussi coach vocal pour l’Institut Canadien d’art vocal (ICAV), organisme en résidence à la Faculté de musique de l’Université de Montréal.
Récemment, il a été invité comme juge pour Jeunesses Musicales Canada et le Concours de musique du Canada. Robin Wheeler est professeur agrégé a la Faculté de musique de l’UdeM. Pendant près de 20 ans, il a été le directeur de l’Atelier d’opéra, qu’il codirige désormais avec Richard Margison.
Richard Margison

Codirecteur de l’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal
Professeur adjoint à la Faculté de musique
Salué pour l’éclat et la beauté de ses notes aigues, le ténor Richard Margison compte parmi les chanteurs d’opéra les plus acclamés par la critique que le pays ait jamais connus. En plus d’être officier de l’Ordre du Canada, il est récipiendaire de trois doctorats honorifiques (McMaster University, University of Victoria et University of British Columbia) et de deux prix pour l’ensemble de ses réalisations (Giulio Gari Foundation et Licia Albanese-Puccini Foundation). Il détient également le titre de membre honoraire, la plus haute distinction du Royal Conservatory of Music.
Au cours des 25 dernières années, Richard Margison s’est produit régulièrement en tant que soliste principal dans les maisons d’opéra les plus prestigieuses, dont le Metropolitan Opera, le Royal Opera House Covent Garden, le Deutsche Oper Berlin, le Vienna Staatsoper, le San Francisco Opera, l’Opera Australia, le Liceu, le Théâtre de La Monnaie, l’Opéra de Montréal, l’Opéra de Québec, le Vancouver Opera, le Calgary Opera, le Manitoba Opera, l’Edmonton Opera et la Canadian Opera company.
Depuis quelques années, il consacre davantage de temps à l’une de ses passion, l’enseignement, afin de contribuer au développement de la prochaine génération d’artistes lyriques. Richard Margison est professeur adjoint en chant classique à la Faculté de musique de l’Université de Montréal, en plus d’être cofondateur et codirecteur artistique du Highlands Opera Studio avec Valerie Kuinka. Par ailleurs, il est directeur artistique de l’Institut canadien d’art vocal (ICAV), organisme en résidence à la Faculté de musique de l’UdeM.
Les moments forts de sa carrière incluent ses interprétations de Bacchus dans Ariadne auf Naxos de Strauss au Teatro Campoamor d’Oviedo, en Espagne; la reprise de son célèbre rôle d’O’Brien dans l’opéra 1984 de Lorin Maazel à Valence; et Radamès dans Aida de Verdi au Metropolitan Opera.
Au cours de la saison 2009-2010, il a participé à l’inauguration de l’Opéra de Canton, en Chine, jouant l’un de ses rôles les plus célèbres, Calaf, dans Turandot de Puccini, sous la direction de Lorin Maazel. « L’un des rare vrai tétor lirico-spinto, avec la capacité de [chanter] les rôles dramatiques les plus lourds, Richard Margison est l’héritier de Plácido Domingo... Il colore sa voix avec une facilité et une spontanéité qui semblent presque conversationnelle, et il chevauche le grand orchestre de Turandot, qui comprend des percussions supplémentaires aux sonorités exotiques, avec aisance et beauté. » (Financial Times, mai 2010).
Sur DVD, on peut voir Richard Margison dans les rôles de Bacchus dans la production Ariane auf Naxos du Metropolitan Opera – aux côtés de Deborah Voigt et de Natalie Dessay –, de Cavaradossi dans Tosca, d’O’Brien dans l’opéra 1984 de Lorin Maazel, et d’Enzo dans La Gioconda de Ponchielli.
Esther Gonthier

Pianiste-cheffe de chant de l’Atelier d’opéra
Esther Gonthier occupe une place de choix dans le monde de l’art vocal québécois. Elle travaille régulièrement à l’Opéra de Montréal, l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Orchestre Métropolitain en tant que pianiste-répétitrice, maître de chant ou assistante au chef d’orchestre.
Elle travaille auprès des étudiant·es en chant à l’Université McGill ainsi qu’à l’Université de Montréal et aussi à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal où elle partage avec joie son expérience auprès des jeunes chanteuses et chanteurs de ces institutions.
Esther est aussi la pianiste-répétitrice auprès des demi-finalistes et finalistes de Voix 2025 lors des répétitions individuelles avec chef Patrick Summers.
Roxane Loumède

Co-metteure en scène
Après avoir complété son baccalauréat en beaux-arts spécialisé en interprétation théâtrale de l’Université Concordia, Roxane Loumède fonde la compagnie Troisième espace théâtre où elle écrit, adapte, met en scène et produit ses premières œuvres. En 2022, elle fait partie des 12 auteurs de la 21e édition du festival le Jamais Lu. Ses mises en scènes ont pu être vues au Théâtre La Chapelle scène contemporaine, au Théâtre le Centaur ainsi qu’à La maison de la culture Maisonneuve. En 2024, elle est la première récipiendaire de la bourse Opsis, donnée par la compagnie du théâtre de l'Opsis récompensant un.e metteur·se en scène de la relève. Présentement, elle collabore avec l’autrice et comédienne Sylvie Drapeau au développement d’une adaptation théâtrale de son dernier roman Le jeu de l’oiseau dont elle signe la mise en scène. Hansel und Gretel sera sa première expérience de mise en scène pour l’Opéra. Ayant étudié la musique plus jeune, elle est ravie de pouvoir travailler sur cette œuvre en compagnie du metteur en scène Patrick R.Lacharité et de renouer avec le monde de la musique.
Patrick R. Lacharité

Co-metteur en scène
Patrick R. Lacharité, diplômé en 2012 de l’École supérieure de théâtre de l’UQÀM, est un comédien et metteur en scène. Depuis le début de sa carrière professionnelle, il a eu l'opportunité de travailler avec de nombreux metteurs en scène tels que Geneviève L. Blais, Alex Trahan, Claire Renaud et Félix-Antoine Boutin. Passionné par la mise en scène, il s'associe à l’auteur Sébastien Tessier pour créer la pièce Ma tête est une ruche et collabore avec le Théâtre Everest pour la création de Bâtardes. En 2016, il devient codirecteur artistique de La Fratrie, où il signe la mise en scène de plusieurs œuvres, dont Mononucléose, Nous serons éternels, Manque de Sarah Kane, Le cas Nicolas Rioux d’Erika Mathieu et Corps et confettis.
À l'hiver 2024, il réalise sa première mise en scène d’opéra avec La flûte enchantée, dirigée par Jean-François Rivest. Il retrouve également avec enthousiasme l’Atelier d'opéra cette année pour mettre en scène Hänsel und Gretel, sous la direction de Geneviève Leclair. En 2025, Patrick signera la mise en scène de Faussaire, qui sera présentée au Périscope et à la RTA.
Gabriela Hébert

Images et projections
Artiste multidisciplinaire, Gabriela Hébert travaille la relation entre le son, l’image et le geste pour créer des expériences immersives et interactives. De la danse à la scénographie, de la musique à la conception du vêtement, de l’installation à la vidéo, elle façonne son parcours artistique en intégrant la technologie à sa pratique, enrichissant ses créations par la composition sonore, l’électronique et la programmation.
Son portfolio, marqué par des visuels pour l’opéra de la Flûte enchantée de Mozart à l’Université de Montréal (2024), une exposition d’une installation sonore au Musée des beaux-arts de Cluj-Napoca (Roumanie), une composition pour synthétiseurs avec performance augmentée au CIRMMT (Montréal), une installation sonore multicanale à Sporobole (Sherbrooke), une performance pour processvisual x Exposé Noir (2023), une composition sonore pour les danseuses Ariane Levasseur et Rozenn Lecompte (Tangente, 2023), des bandes sonores pour des défilés de mode présentées à la Société des Arts Technologiques et à la Toronto Fashion Week (2019), un court métrage en réalité virtuelle pour le Festival SOIR (2018), ainsi que de nombreuses performances en collaboration, révèle une exploration constante des frontières artistiques entre art vivant et numérique.
Chanaël Burat

Costumes
Artiste multidisciplinaire, Chanaël Burat a débuté son parcours créatif dans le milieu des beaux-arts et de l’illustration. Sa passion pour la mode et le design l’a conduite à suivre une formation en Mode et confection de vêtements sur mesure à l’École des métiers des Faubourgs-de-Montréal, où elle a obtenu son diplôme en 2020. Elle s’est ensuite lancée dans le monde du costume en cinéma et en télévision, co-créant plusieurs costumes pour des vidéoclips d’artistes et interprètes québécois, notamment pour Vies antérieures de Gab Paquet (2022), Nitanis Anaïs de Laura Niquay (2022) et Nulle part sauf ici de Karolan Boily (2023). La production d’Hänsel und Gretel est l’occasion pour Chanaël de présenter pour la première fois son univers artistique en tant que conceptrice de costumes de scène. Son concept allie un mélange d’inspirations organiques, de folklore et de modernité.
Catherine Fée-Pigeon

Éclairages
Catherine Fée-Pigeon, éclairagiste des arts vivants depuis 2013, allie habilement sa passion pour l'éclairage et les arts médiatiques. C'est au cours de ses études en Intermedia and Cyberarts à Concordia qu’iel fait ses premiers pas dans le monde de la scène en éclairant les performances du Art Matters Festival. Dès lors, l'éclairage devient le pilier central de sa pratique artistique et reste toujours étroitement liée aux nouvelles technologies.
Ses créations sont souvent le fruit d’une approche technique complexe, mêlant programmation avancée, utilisation de logiciels tiers et dispositifs électroniques. Forte de ses expériences dans le domaine musical, Catherine élargit ses compétences en programmation en direct, enrichissant ainsi ses conceptions pour le théâtre et la danse. De manière réciproque, son travail dans le domaine musical imprègne ses créations d'une dimension théâtrale unique.
Au cours des dernières années, Catherine a tourné avec le spectacle Crash de l'artiste Les Louanges, et a conçu les éclairages pour les derniers spectacles de Claire Renaud, Laakkuluk Williamson Bathory, Pénélope Deraîche-Dallaire et Claudia Chan Tak. Son implication ne se limite pas à l'éclairage; iel a également incarné un personnage secondaire dans le spectacle Explosion de la compagnie queer et féministe Pleurer Dans’ Douche, tout en continuant de mettre en lumière l'ensemble de la production.
Natacha Filiatrault
 |
Coiffures et maquillages
Natacha Filiatrault évolue comme artiste depuis 2005. Véritable touche à tout, elle s’intéresse autant au jeu et à la danse qu’au maquillage et à la coiffure. Elle signe la conception de plusieurs productions de théâtre et de cirque (Les géants de Machine de Cirque 2022, Whitehorse de Couronne Nord, Le ciel est une belle ordure du Théâtre de l’Opsis).
Sa solide connaissance du travail d’interprète lui permet de concevoir des maquillages et des coiffures qui aident les comédiens à construire leurs personnages.
Laura Kubler

Assistance à la mise en scène et régie
Étudiante internationale (Toulouse, Berlin, Montréal) depuis 2015, Laura Kubler est titulaire d’une maîtrise de musicologie en recherche-création à l’Université de Montréal qui porte sur la réactualisation de mises en scène d’opéra à travers un prisme féministe. Elle est actuellement étudiante au DESS en médiation de la musique à l’UdeM.
Depuis l’obtention de sa maîtrise en 2022, Laura travaille en tant que régisseuse plateau (Orchestre National du Capitole), ouvreuse et tourneuse de pages (Piano aux Jacobins), ainsi que technicienne instrument et régisseuse vidéo (Toulouse les Orgues). Côté opératique, elle a pu approfondir ses qualités de régisseuse et d’assistante à la mise en scène en travaillant aux côtés d’Alain Gauthier (La vie Parisienne à l’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal, ainsi que sur celle de Written On Skin à l’Opéra de Montréal) et à Saluzzo Opera Academy (Le couronnement de Poppée et Don Giovanni).
Depuis mars 2024, elle travaille comme médiatrice pour plusieurs organismes québécois (Orchestre Symphonique de Montréal, Orchestre Métropolitain, l’OBNL Chants Libres, la compagnie Ballet Opéra Pantomime, mais aussi l’Opéra de Montréal.)
Aujourd’hui, c’est sa casquette d’assistante-metteuse en scène et de régisseuse qu’elle utilise, afin d’occuper à la fois le poste de responsable pour l’OUM, ainsi que celui d’assister Patrick R. Lacharité et Roxane Loumède pour l’opéra Hänsel und Gretel.
Carl Pelletier

Accessoires et décors
Carl Pelletier possède un parcours singulier : études collégiales en architecture, puis en conception de décors et costumes au Collège Lionel-Groulx. Diplômé en arts et en infographie du Collège de Maisonneuve, autodidacte en peinture scénique, il s’intéresse aux arts visuels. Il a touché au théâtre, au monde de la variété et à l’univers lyrique. Dans son parcours de créateur, il a touché au théâtre, au monde de la variété et à l’univers lyrique. Il a réalisé la scénographie de Barbe-Bleue (Opéra comique du Québec), Chanson gitane (Théâtre lyrique de Boucherville), Mélodies du Broadway (avec le Chœur MRC). En 2008, il faisait un retour à l’opérette avec la scénographie d’une production de Die Fledermaus, à la Faculté de musique.
Il a collaboré à plusieurs productions de l’Atelier d’opéra de l’UdeM: scénographie de Der Zigeunerbaron (2008), avec l’artiste visuelle Caroline Guilbault, et de Giulio Cesare (2011); costumes et accessoires pour Pelléas et Mélisande (2012); décors, costumes et accessoires pour Dialogues des carmélites (2013), et pour Suor Angelica et Gianni Schicchi (2014); décors pour L’étoile (2015); décors et accessoires pour Le nozze di Figaro (2016) et pour L’enfant et les sortilèges (2017). Récemment, il a conçu les décors et accessoires pour A Midsummer Night’s Dream de Britten (2018), La vie parisienne d’Offenbach (2020), Idomeneo de Mozart (webdiffusion, 2021) et La tragédie de Carmen d’après Bizet (2022), La chauve-souris de Strauss II (2023) et La flûte enchantée de Mozart (2024).
À travers les productions pour l’Atelier d’opéra de l’UdeM, il développe une vision écoresponsable de la scénographie en appliquant les principes des 3R : réduire, réemployer et recycler. Ceci permettant une réduction notable de déchets pour l'environnement.
Les musiciennes et musiciens

VIOLONS I VIOLONS II ALTOS | VIOLONCELLES CONTREBASSE FLÛTES PICCOLO HAUTBOIS CLARINETTE BASSON | CORS TROMPETTE TIMBALES PERCUSSIONS HARPE |
*surnuméraire
L'œuvre
L’œuvre Hänsel und Gretel d’Engelbert Humperdinck, composée en 1893, est sans doute l'un des opéras les plus célèbres et les plus joués du compositeur allemand, en particulier pour les fêtes de Noël. Ce « conte de fées mis en musique », initialement prévu pour être joué dans un cadre familial, connaît un succès qui lui permet de conquérir la scène opératique mondiale. La profondeur du livret sait séduire petits et grands, sans se limiter à un public d’enfants.
À travers cet opéra, Humperdinck réussit à allier des éléments folkloriques allemands à une orchestration et une écriture vocale marquée par Wagner, son maître. L’enjeu est de retracer les grandes étapes de cette réussite, en mettant en lumière les circonstances de sa création, l’hommage à Wagner, l’exploration du conte de fées en musique et la dimension initiatique de l’œuvre.
Un succès domestique qui devient un triomphe mondial
L’histoire de Hänsel und Gretel commence presque par hasard : en 1888, la sœur d’Engelbert Humperdinck, Adelheid, lui demande de composer des chansons pour illustrer un conte de fées qu’elle avait inventé pour ses enfants, inspiré de l’histoire de Blanche-Neige. Ce succès domestique auprès de ses proches incite Humperdinck à composer davantage pour ses neveux et nièces. Cela donne finalement naissance à l’idée de créer un véritable opéra pour la scène, sur la base des contes populaires allemands. Humperdinck se tourne alors vers le recueil Kinder und Hausmärchen (Contes de l'enfance et du foyer) des frères Grimm, où figure Hänsel und Gretel.
L’adaptation du texte de Hansel und Gretel par sa sœur Adelheid apporte une touche de douceur et de magie, en évitant les aspects trop sombres du conte originel, comme l'abandon des enfants dans la forêt. Elle introduit dans cette nouvelle version des éléments fantastiques tels que le marchand de sable et la fée Rosée. L’œuvre reçoit un accueil enthousiaste lors de ses premières représentations à Weimar, Munich et Karlsruhe en 1893, sous la direction de chefs d’orchestre allemands de premier plan tels que Richard Strauss, Hermann Levi et Felix Mottl. Immédiatement, Hänsel und Gretel connaît un véritable succès, d’abord en Allemagne, puis à travers le monde : il est joué en 1894 à Londres, et en 1895 à New York. Sa première française est plus tardive, puisqu’elle a lieu en 1900 à l’Opéra-Comique, mais elle rencontre un franc succès. Le dramaturge Catulle Mendes écrit même un livret en français pour cet opéra, gage de l’intérêt qu’il suscite.
L’omniprésence de Wagner et l’identité germanique
L’une des caractéristiques les plus frappantes de Hänsel und Gretel est l'influence profonde de Richard Wagner, sous lequel Humperdinck avait travaillé en tant qu’assistant dans les années 1880. La structure de l’opéra, notamment la technique du durchkomponiert (composition continue), témoigne de cette influence. Ce procédé, qui consiste à lier les différentes sections de l’œuvre sans structure apparente et marquée, était une des innovations majeures de Wagner, et Humperdinck l’utilise pour créer une progression dramatique fluide et implacable entre les scènes.
L’orchestration de Hänsel und Gretel est également un hommage à Wagner, avec une utilisation du chromatisme et une orchestration riche, qui peut par moments être comparée à celle de Parsifal ou du Crépuscule des Dieux. Humperdinck exploite la technique des leitmotivs, ces motifs musicaux associés à des personnages ou à des idées, qui étaient au cœur de l’esthétique wagnérienne. On peut ainsi entendre dans la musique des scènes comme celle de la chevauchée de la sorcière des éléments qui rappellent la grandeur épique des Walkyries. Cependant, Humperdinck n’hésite pas à parodier Wagner, en transformant une scène dramatique en une sorte de course burlesque autour de la maison en pain d’épices.
D’autres moments purement instrumentaux comme le Prélude du premier acte et le pantomime des anges à la fin du second acte, précédé par le duo « Abends, will ich schlafen geh’n » frappent par leur lyrisme post-romantique, à un point tel que Strauss s’inspirera de ce duo pour l’écriture du finale de son Rosenkavalier.
En quête d’une identité propre : l'exploration du conte de fées
Si Hänsel und Gretel puise ses racines dans les contes populaires allemands, il ne s'agit pas d’une simple illustration musicale des récits des frères Grimm. Humperdinck et sa sœur ont su leur insuffler une dimension plus magique, faisant du conte initial un Märchenspiel (« jeu de conte de fées »), en particulier grâce à l’introduction du marchand de sable et la fée Rosée. Ces figures interviennent non seulement pour orienter le destin des enfants, mais aussi pour ajouter une dimension fantastique qui éloigne l’œuvre du réalisme brut du conte originel.
L’aspect folklorique de l’œuvre, aux mélodies simples et à l’atmosphère parfois presque naïve, est également un moyen pour Humperdinck d’explorer une identité musicale allemande. Certains airs sont tirés de chants populaires authentiques, tandis que d’autres utilisent des extraits du recueil « Des Knaben Wunderhorn » (Le cor merveilleux de l’enfant), publié en 1805 par Clemens Brentano et Achim von Arnim. Ce recueil d’environ mille chants populaires allemands du moyen-âge au dix-neuvième siècle est une source d’inspiration majeure dans laquelle ont puisé des compositeurs allemands tels que Brahms et Mahler.
L’opéra est ainsi une synthèse entre les racines populaires de l'Allemagne et les avancées musicales de l’époque, et il marque un tournant dans la recherche d’une identité musicale propre, à la fois ancrée dans le passé et résolument moderne.
Une œuvre enfantine, mais un parcours initiatique profond
Malgré son ancrage dans l'univers de l'enfance et la distance prise avec certains points du conte de Grimm (la belle-mère est dans le livret leur mère biologique, elle les envoie dans la forêt pour cueillir des fraises sans l’intention de les abandonner ; une fois le père revenu, ils partent d’ailleurs à leur recherche et les retrouvent à la fin de l’opéra), Hänsel und Gretel offre une profondeur dramatique qui évoque un véritable parcours initiatique. La sortie du foyer et l’errance dans la forêt symbolise le détachement de l’enfance pour entrer dans un monde plus complexe et dangereux. Le marchand de sable et la fée Rosée, ajouts du livret, agissent comme agents et accompagnent les personnages dans le passage de l’innocence enfantine à l’âge adulte. L’opéra met en lumière la croissance personnelle des enfants qui, confrontés à la sorcière et à leurs peurs, doivent trouver leur propre voie et se faire leurs propres armes pour sortir victorieux.
Cette dimension initiatique trouve un écho particulier dans une époque marquée par la pensée psychanalytique freudienne naissante, qui s’intéresse de près à l’inconscient et aux processus de passage à l’âge adulte.
Hänsel und Gretel d’Engelbert Humperdinck est donc une œuvre complexe et fascinante, qui allie la tradition folklorique allemande à une écriture musicale moderne. L’opéra est le fruit de la quête d’une identité musicale propre, inspirée par Wagner (avec parfois une certaine dérision) mais s’en éloignant pour explorer l’univers des contes de fées. Bien que l'œuvre soit ancrée dans le monde de l'enfance, elle offre également une profonde réflexion sur le passage à l’âge adulte, un parcours initiatique qui résonne avec les préoccupations de l’époque. Tous ces éléments ont assuré une pérennité de Hänsel und Gretel et en font un opéra allemand incontournable.
Notes de programmes rédigées par Arthur Prieur, étudiant au doctorat en interprétation, sous la supervision de Sylveline Bourion, professeure agrégée à la Faculté de musique de l'UdeM.
Professeurs en chant classique de la Faculté de musique
Ariane Girard
Richard Margison
Monique Pagé
Équipe pour Hänsel und Gretel
Chef, production culturelle et musicale
Benoit Bilodeau
Consultant à la projection vidéo
Yves Arsenault
Coordonnateur aux activités scéniques
Sébastien Besson
Coordonnatrice aux événements spéciaux
Sarah Joyal
Technicien à la production-sonorisation et enregistrement
Olivier Gagnon
Techniciens à la production
Serge Pelletier
Lou Arbour
Auxiliaire d'enseignement pour l’OUM
Laura Kubler
Merci de votre soutien
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des donatrices et des donateurs de la Faculté de musique de l’Université de Montréal. Ce soir, l’équipe facultaire salue tout particulièrement les donatrices et donateurs qui ont contribué aux différents fonds qui rendent possible cette production de La flûte enchantée :
- Fonds de production d'Atelier d'opéra
- Fonds de soutien à l'Atelier d'opéra
- Fonds Atelier d'opéra Casavant
Événements à venir
Pour ne rien manquer
Pour tout savoir et ne rien manquer des actualités et événements de la Faculté de musique, abonnez-vous à notre infolettre!